Blog




Je vous écrie de mon petit bout de paradis
Aujourd'hui, je suis content. J'ai mis la dernière main à un recueil de nouvelles (courtes, très courtes, de 4 pages à 1 ligne). Le thème : le travail. Précisément, celui d'un infirmier.
Cela aurait pu s'appeler : '' Les tribulations d'un infirmier à l'hôpital, dans la rue, chez les gens, en asso, en CMP, Hôpitaux de jour, etc... ''
Mais comme il faut faire court, je l'ai appelé :
'' SUR LE VIF '', avant de l'envoyer à quelques amis et une maison d'édition.

Bonne émission sur France Culture, à recommander.

L’expérience de Alain Vircondelet, écrivain : Ecrire une biographie
On apprend de cet ouvrage captivant et bien écrit plusieurs choses. Je les jette sur l'écran de l'ordinateur, sans chercher à les ordonner.
D'abord que la notion d'âme russe est une impasse, un cul de sac dans lequel on s'est fourvoyé. Une notion inventée et reflètant notre besoin d'exotisme, mais qui n'est pas opérante pour comprendre la littérature russe.
Ensuite que la littérature russe se résume, souvent, en France, au couple Tolstoï / Dostoïevski. L'auteur les cite toujours par deux, comme on dirait '' Sartre et Camus '', '' Voltaire et Rousseau '', '' Goethe et Shiller ''. Pour autant, Serge Rolet affirme que le couple Tolstoï / Dostoïevski est l'arbre qui cache la forêt. En dehors d'eux, selon lui, la littérature russe est encore méconnue. Il me vient à l'idée que des écrivains comme Boulgakov, Tchekhov, Babel, sont parvenus à se tracer un chemin parmi le lectorat français. Pour autant, cela n'invalide pas cette idée d'une littérature méconnue.
Serge Rolet parle de l'héritage tatar de la littérature russe. Au monde tatar est associé le plus souvent l'idée du '' tsarisme ''. C'est à dire du pouvoir absolu, qui depuis Pierre le Grand, jusqu'à Poutine, fait le malheur de la Russie et de ses voisins.
Néanmoins, nous nous doutons moins que la steppe est associée, aussi, à la liberté, dans la littérature russe. Que les gens qui la parcourent, les cosaques, les tsyganes, sont tous associés au souhait de liberté des écrivains russes. Souhait qui parcoure toute la littérature russe, mais qui n'est jamais advenue dans l'histoire de ce pays. Et donc la steppe... Et les nomades... Dans cette société figée, ce sont des modèles. Il leur revient à ces nomades de porter les aspirations de liberté des écrivains et de leurs lecteurs.
Dans ce combat pour la liberté, l'autocratie est la cible. Mais aussi la figure du petit bourgeois. Ce qu'on reproche au petit bourgeois, c'est d'être limité. Ce qui veut dire étroit d'esprit et étriqué. Toutes choses dont la steppe et ses habitants nomades sont exactement le contraire, l'image inversée. Prime de sympathie accordée au nomade. Dévalorisation des petits bourgeois vus comme des personnes '' limitées ''. Là, une incise personnelle, qui vaut ce qu'elle vaut. Peut-être pas grand chose. Il me semble que les valeurs portées par les écrivains de la beat génération sont les mêmes. Et ce rapprochement, dans la mesure où j'aime ces deux littératures, m'intrigue beaucoup. Serait-il possible de rapprocher les écrivains de la beat generation et les écrivains russes ? Pourquoi pas ? Est-c e que je ne surinterprète pas ? En tout cas, ces littératures servent, ici, d'armes de subversion. Elles établissent le portrait d'un même individu, un archétype, que par facilité nous nommons '' le petit bourgeois '', dont il convient de se départir, de suivre le chemin inverse, si nous ne voulons pas nous affadir et passer à côté de la vie.
Autre élément particulier et autrement plus important de la littérature russe. Tandis que littérature pour nous est synonyme de pouvoir tout dire. Et c'est pourquoi Littel dans '' les bienveillantes '' ne tombe pas sous le coup de la loi. La littérature russe, parce qu'elle est seule contre le pouvoir dictatorial du tsarisme, est investie d'une mission. Elle ne répond pas simplement d'elle même, comme la littérature française. Elle engage. Elle engage les aspirations de tout un peuple. La différence est de taille.
Il en découle que les russes aiment les histoires vraies. Ils se méfient de l'invention en littérature. Des '' trucs '' littéraires pour structurer un récit. Oui, pour les russes, ces façons d'ordonner un récit sonnent faux. Mission est faite à la littérature russe, au contraire, de dire le vrai. Et à partir de cette constatation, Serge Rollet explore des chemins inconnus. Comment disent-ils, selon eux, le vrai ? Pourquoi ? Comment ? Je vous invite à lire cet ouvrage. Il secoue vraiment quelques idées reçues et ouvre des perspectives. Si vous pratiquez l'écriture, cela devrait vous inspirer.
En conclusion et en guise d'éllipse, il me revient une anecdote racontée par un écrivain russe.
Dans mon pays, disait-il, écrire est facile. Pour établir un récit, il suffit de se poster à la porte de son immeuble. Puis, de noter ce qui se passe dans la rue. Un fois fait, vous remontez dans votre appartement et obtenez un très bon livre. Par contre, la vie chez nous est difficile...
'' QU'EST-CE QUE LA LITTÉRATURE RUSSE ? '' SERGE ROLET
NOTES EN VRAC
REVUE
DES ÉTUDES SLAVES
Serge Rolet, Qu’est-ce que la littérature russe ? Introduction à la lecture des classiques (XIXe-XXe siècles)
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2019
Caroline Bérenger
p. 378-379
Référence(s) :
Serge Rolet, Qu’est-ce que la littérature russe ? Introduction à la lecture des classiques (XIXe-XXe siècles), Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2019, 195 p. ISBN 978-2-7574-2925-9
1 Jean Bonamour, la Littérature russe, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1992, 126 p. Histoire de la lit (...)
1Comment écrire une autre histoire de la littérature russe ? La réflexion est en cours parmi les slavistes en France. Une histoire déjà écrite, il est vrai, mais du précis synthétique « Que sais-je ? » à la monumentale encyclopédie collective1, ses variations d’amplitude interrogent. L’ouvrage de Serge Rolet est une contribution stimulante à ce vaste chantier. « Qu’est-ce que la littérature russe ? », de quoi parle-t-on ? comment y entrer ? Le titre met l’accent sur la définition du sujet, sur la possibilité même de le définir, et annonce une rupture méthodologique et heuristique. L’auteur procède à un renversement de perspective : il s’écarte de la démarche du spécialiste pour adopter le point de vue du non initié ; il propose des clés d’accès à la littérature russe, celles dont il aurait aimé disposer lorsqu’il était sur les bancs de l’université. Ces points de repère qu’il a mis en place au fil de ses cours construisent un cheminement balisé pour accéder peu à peu à la complexité de la matière. La question initiale reste sans réponse mais déclenche une dynamique de questionnements et de découvertes.
2Le fil conducteur de cette étude est la notion de point de vue. C’est le principe posé dans l’introduction « La littérature russe et nous ». En effet, le code de lecture et les repères implicites jouent un rôle primordial. L’âme russe est un bon indicateur de la force suggestive des stéréotypes et des malentendus qu’ils génèrent.
3La première partie de l’ouvrage esquisse le cadre temporel de la littérature russe. L’auteur revient sur les difficultés que soulève sa périodisation, les fluctuations chronologiques qui s’étendent sur plusieurs siècles : « Comment une littérature qui existe depuis le xiie siècle peut-elle vraiment commencer au xviiie siècle, et n’avoir encore aucune réalité un siècle après ? » Cependant, certaines dates clés permettent de poser des jalons solides. Ces faits historiques peuvent être convertis en éléments culturels : 1485 et la steppe, 1703 et l’européanisation, etc. sur le modèle des sites de la mémoire russe de Georges Nivat. La dimension spatiale est abordée à partir des notions de centralité et de périphérie. La littérature russe s’est toujours pensée dans les marges, à l’inverse de la littérature européenne dont elle a subi l’influence, et qui fonctionne de façon autoréférentielle. L’auteur met en évidence les dynamiques inversées de ces deux espaces littéraires.
4Les chapitres suivants sont consacrés à la fonction de la littérature russe dans la société. Là encore la comparaison est éclairante. La littérature française s’autorise à tout exprimer et rachète sa liberté par l’engagement. La littérature russe est fondée au contraire sur une responsabilité de principe, elle doit répondre de ses mots, c’est ce qui accroît son pouvoir d’action en dehors de la sphère esthétique. Appliquée à la littérature russe, la « French Theory » se heurte à ses limites. La lecture transcendante que propose Jacques Derrida est une épreuve de vérité qui s’exerce a posteriori en terrain français, mais elle est peut-être moins pertinente pour la littérature russe qui est chargée a priori d’une mission à accomplir. La lecture sociologique de Pierre Bourdieu semble peu opérationnelle à l’époque soviétique, alors que les rapports entre l’art et le pouvoir brouillent les pôles de domination.
5Un exemple éloquent des interactions étroites qui s’exercent entre le champ littéraire et le champ social est celui de la réception de Nicolas Gogol. Serge Rolet confronte deux lectures de son œuvre et montre comment le critique en Russie, en la personne de Bielinski, a pris l’ascendant sur le romancier, car c’est lui qui détermine le poids de l’œuvre artistique dans le monde réel. Cependant, les courants esthétiques ont un impact plus profond que les enjeux idéologiques : dans l’œuvre de Gogol, le réalisme se voit débordé par l’intrusion du fantastique. Quant au débat entre slavophiles et occidentalistes, il témoigne tout autant d’une conception politique que d’une vision artistique de l’identité russe. Dans ce contexte, l’homme de trop et le petit homme incarnent le conflit entre l’individu et la société.
6Dans la dernière partie, l’auteur explore la dimension prophétique de la littérature russe et son rapport à la vérité. Une vérité ambivalente qui repose sur la coexistence de plusieurs codes de lecture souvent incompatibles dans une même œuvre. De plus, la représentation de la réalité et le réalisme répondent à d’autres impératifs. La littérature russe intègre le matériau de la vie réelle : elle acquiert sa légitimité à partir de la « littérature du fait ». C’est à cette condition que la fiction retrouve ses prérogatives. La mimesis aristotélicienne s’exerce au sens plein, non pas comme imitation mais recréation de la nature.
7Serge Rolet ose revenir sur des évidences qui n’en sont pas, c’est pourquoi son livre est essentiel. Il parvient à concilier l’exigence du propos scientifique avec le souci de sa diffusion, dans une langue plus ouverte, auprès d’un public plus large. Il considère la littérature russe dans sa globalité, en diachronie et en synchronie, à travers ses grands axes et ses points saillants. Pour compenser la tendance à simplifier et à généraliser que suppose la valorisation, il réintroduit des éléments de différenciation en alternant des séquences panoramiques et focales, en pratiquant le dédoublement du point de vue, en montrant la réversibilité des interprétations pour mettre en évidence l’existence d’un « absolu relatif ». La confrontation de ces différents angles d’approche permet de construire une vision composite, selon la technique de Lermontov dans son roman Un héros de notre temps qui restitue les facettes du héros Petchorine, en multipliant les points d’observation.
8La démarche transversale et multidisciplinaire, le déplacement et l’élargissement des concepts sont des tendances de fond que l’on observe depuis quelque temps dans les sciences humaines. Elles conduisent à une hybridation des savoirs assez inconfortable qui peut être remise en cause. L’ouvrage de Serge Rolet n’est ni un commentaire, ni un essai, ni un manuel, ni une étude spécialisée. C’est une proposition innovante pour reconfigurer notre objet d’étude, réaménager notre connaissance de la littérature russe, assurer une fluidité plus grande entre pédagogie et recherche. L’histoire de cette littérature a été écrite par plusieurs générations de slavistes français de renom au cours du xxe siècle. Il incombe à ceux du xxie d’assimiler la richesse foisonnante du matériau et de réinventer les conditions de sa transmission.
Caroline Bérenger
Université Caen-Normandie
Articles du même auteur
Bibliographie des travaux de Michel Aucouturier depuis 2005 [Texte intégral]
Paru dans Revue des études slaves, LXXXIX-3 | 2018

Un siècle d'écrivains : Boris Vian
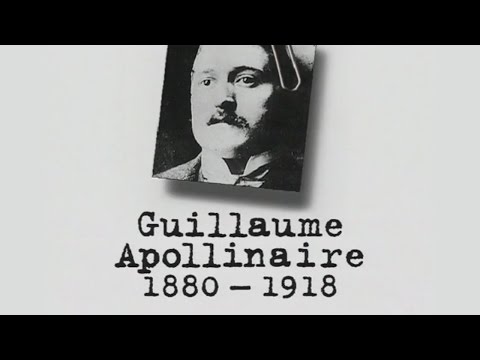
Un siècle d'écrivains : Guillaume Apollinaire
Un siècle d'écrivains. Une émission qui en son temps , c'est à dire à la fin du XXème siècle, il y a maintenant... longtemps... m'a beaucoup marqué. Un plaisir de vous transmettre quelques numéros de émission, rendant hommage à des monstres littéraires du siècle passé et au talent fou.
Un siècle d'écrivains : Jack Kerouac

Un siècle d'écrivains : William Burrougs

Une nouvelle extraite du recueil : '' SUR LE VIF ''.
Thème : le travail. Plus précisément, les tribulations d'un infirmier à ses différents postes de travail.
Les rencontres, les rapports entre collègues, les logiques institutionnelles, le découragement, le rire, l'aliénation...
FRONTIÈRES EN TÊTE
Ma tête n'est pas seulement un échangeur ferroviaire, comme l'affirmait Bashlachev. Mais aussi un endroit plein de coutures, de cicatrices et de fêlures, de fossés et de frontières.
Un exemple.
J'ai mis trois mois pour me rendre compte que l'endroit où je vivais se situait dans la même mégalopole que celui où je travaillais.
Les deux, le centre de Marseille et ses quartiers pauvres du nord, semblant appartenir à des planêtes différentes. En gros, pour ceux qui sont coutumiers de l'univers de Star Wars : Anaxes, avec ses montagnes, ses rivières et ses humains. Et Mustafar, avec ses volcans, ses rivières de lave et ses mustafariens.
Personne autour de moi n'a jamais entendu parler des mustafariens. Pourquoi se rendre sur une planète de lave, et qu'est-ce qu'on aurait à y foutre ? Si l'on cherchait des embrouilles... Pas mieux...
À l'inverse, je connaissais quelques pré-ados mustafariens, qui auraient volontiers découvert Anaxes. Enfin, à ce moment là, je crois que ça m'échappait.
Il a fallu que le petit Jordan (un prénom typique de Mustafar) me demande l'autorisation de visiter ma planète. La surprise ! Bouleversé, j'ai accédé à sa demande. Et je l'ai emmené dans mon vaisseau déglingué. Une 205 pourrave, prêtée par l'hôpital psy de mon bled. « Quand on part bosser chez les mustafariens pour leur venir en aide soi disant, rien de tel que ces tas de boue !» m'avait soufflé un garagiste de l'hosto.
Trajet compliqué...
Beaucoup d'embouteillages sur Anaxes.
Une fois parvenu à destination, Jordan est descendu de ma chèvre intergalactique.
Là, il a découvert que nos deux planètes opposées se réunissaient, pourtant, au sein d'une même mégalopolis. Il a trouvé ça très beau, tout comme moi. Du haut de la Bonne-Mère, veillant sur chacun des habitants de Mustafar et d'Anaxes, on apercevait son quartier. Mais aussi l'Estaque, le port... La mer... le Vieux-Port. Tout... Fabuleux...
Jordan et moi, on s'est laissé transporter par la magie. Je voyais bien à ses yeux (oui, les mustafariens ont des yeux), qu'il en pinçait pour la beauté du paysage. Puis, quand le petit est revenu s'asseoir dans ma 205 de l'espace, il a déclaré...
— Écoute... Je voudrais me marier avec une des filles d'Anaxes. C'est possible ?

Jack London, l'écrivain qui a marqué mon enfance.
'' Jack London, l'écriture sauvage ''. Un point sur sa vie intriquée à son oeuvre.

Jack London : ses conseils d'écriture. Une source d'inspiration dans la pratique de l'écriture.
